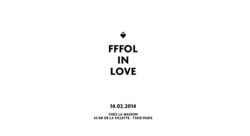p.150 :
"La professionnalisation de la gaytitude exige une certaine théâtralité pour produire un "soi", effet constitué d’un discours qui revendique néanmoins, de "représenter" ce soi comme vérité première. En 1989, avant de présenter cet exposé à la conférence sur l’homosexualité, je me suis surprise à dire à mes amis que je partais à Yale pour être une lesbienne. Cela ne signifiait pas, bien sûr, qu’avant je ne l’étais pas, mais, qu’en somme, maintenant, en parlant dans ce contexte, je "l’étais" d’une façon plus précise et plus complète, au moins pendant le temps du colloque. Ainsi en suis-je une, ès qualités, et même sans ambiguïté. Lesbienne, je l’étais depuis l’âge de 16 ans. Alors pourquoi cette angoisse, cette gêne ? Eh bien, cela n’est pas sans rapport avec le fait que je redouble d’efforts, à Yale, pour être une lesbienne ; une lesbienne, il se trouve que je le suis depuis si longtemps ! Comment se fait-il que je puisse à la fois en "être" une, et m’efforcer de l’être ? Quand et où mon être de lesbienne est-il entré en scène, quand et où jouer la lesbienne établit-il quelque chose de ce que je suis ? Dire que je joue ne revient pas à affirmer que je ne le suis pas "réellement" ; mieux vaudrait dire qu’en jouant, cet "être" s’établit, s’institue, se meut et se confirme. Ce n’est pas une représentation théâtrale, d’où je peux radicalement m’écarter, car c’est une pièce solide, installée, retranchée dans le psychisme et ce "je" ne joue pas son lesbianisme comme un rôle. Plutôt, à chaque représentation, le je se reconstitue t-il, de manière insistante, en je de lesbienne. Paradoxalement, c’est précisément la réitération de la pièce qui établit ainsi l’instabilité de la catégorie même qu’elle institue. Car si le je ne fait qu’accomplir un semblant d’identité à travers une certaine répétition de lui-même, le je se déplace toujours avec la répétition même qui le soutient. En d’autres termes, le je peut-il jamais se répéter lui-même, se citer lui-même fidèlement, ou, trouvera t-on toujours un déplacement de ce moment premier, qui fonde la permanence d’un statut de non-identité à soi de ce je ou de son "être-lesbienne" ? Ce qui "joue" n’épuise pas complètement le je ; il ne déploie pas en termes visibles la satisfaction complète du je, car, si les représentations se répètent, se pose la question de savoir ce qui différencie les divers moments d’identité ainsi rejoués. Si le je est l’effet d’une certaine répétition, celle qui produit un semblant de continuité ou de cohérence, aucun je mis en scène ne précède le genre. La répétition et son échec produisent une chaîne de représentations qui fonde et conteste la cohérence de ce je."
(...) p.152 :
"La vie politique américaine contemporaine dispose d’un nombre considérable de moyens pour stigmatiser précisément le lesbianisme comme ce qui ne saurait ou ne devrait pas être. En un sens, les attaques de Jesse Helms [1] sur le NEA [2], destinées à sanctionner les représentations de "l’homo-érotisme", rassemblent, à partir du travail de Robert Mapplethorpe [3], des fantaisies homophobes variées, sur ce que sont et font les hommes gay. Selon Helms, les hommes gay n’existent que comme objets défendus ; ils sont, dans ces récits tarabiscotés, des sadomasos, exploiteurs d’enfants, exemples paradigmatiques d’"obscénité" ; les lesbiennes, quant à elles, dans ce discours, n’accèdent pas même au rang d’objets d’interdiction. L’oppression ne repose pas simplement sur des interdits explicites, mais aussi implicitement, sur la constitution de sujets jugés viables avec, pour corollaire, la désignation de tout un plan de (non-)sujets non viables, abjects en somme, qui ne sont ni nommés ni interdits dans le registre de la loi. Ici l’oppression fonctionne par la production d’un domaine de l’impensable et de l’innommable. Le lesbianisme n’est pas explicitement défendu puisqu’il n’a même pas fait son chemin jusqu’au pensable, l’imaginable -cette grille de lecture qui appartient à la culture et régule le réel et le nommable. Alors, comment "être" une lesbienne, dans un contexte politique qui guerroie durement contre le lesbianisme en cherchant à l’exclure du discours lui-même, au moins en partie ? Un interdit explicite délimite une place dans le discours, d’où un contre-discours peut toujours se construire ; une proscription implicite ne qualifie mêle pas un objet interdit [4]. Bien que des homosexualités de toutes sortes aient été, dans le contexte actuel, arasées, réduites puis réintégrées dans des fantasmagories radicalement homophobes, il est important de remonter les filières par lesquelles l’impensable de l"homosexualité ne cesse de se reconstituer.
L’exclusion hors du discours est une chose, la présence en son sein sous forme de mensonge durable en est une autre. Voilà pourquoi rendre visible le lesbianisme devient un impératif politique ; reste à savoir comment s’y prendre, en dehors ou dans les organes de régulations ordinaires. L’exclusion de l’ontologie suffit-elle à rallier des gens pour y résister ?"
Ce texte est traduit de l’américain par Eliane Sokol. Il est paru aux Etats-Unis sous le titre "Imitation and Gender Insubordination" in Diana Fuss (ed.), Inside Out : Lesbian Theories, Gay Theories, New York, Routledge, 1991.
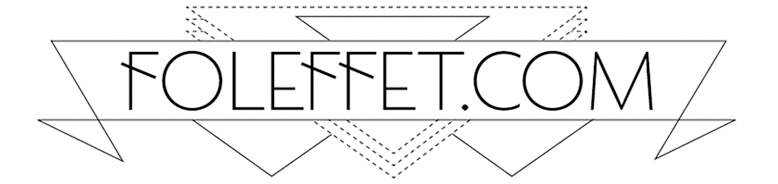
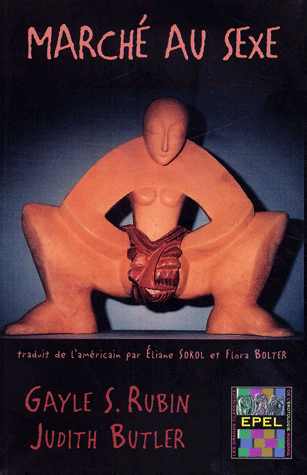
 riends
riends