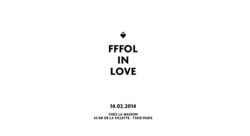Fragment 3c
Chapitre II : La question de la guerre
p.153
"S’il est vrai qu’une chose n’est réellement dans le monde historico-politique tout comme dans le monde sensible que lorsqu’elle se montre sous tous ses aspects, alors il faut toujours une pluralité d’hommes, ou de peuples ou de positions, pour que la réalité soit possible et pour lui garantir la continuité. En d’autres termes, le monde ne surgit que parce qu’il y a des perspectives, et il existe uniquement en fonction de telle ou telle perception de l’agencement des choses du monde. Lorsqu’un peuple - qui occupait une position telle dans le monde que personne ne peut immédiatement la reproduire, dans la mesure où ce peuple présente toujours une vision du monde que lui seul peut incarner - une ville ou même seulement un groupe de personnes est détruit, ce n’est pas seulement un peuple, une ville ni même un certain nombre d’hommes qui est détruit, mais une partie du monde commun qui se trouve anéantie : un aspect sous lequel le monde se montrait et qui ne pourra plus jamais se montrer. L’anéantissement ici n’équivaut donc pas simplement à une forme de disparition du monde, mais concerne également celui qui a perpétré cet anéantissement. La politique au sens strict du terme n’est pas tant affaire aux hommes qu’au monde qui est entre eux et qui leur survivra ; dans la mesure où elle est devenue destructrice, et où elle provoque la ruine du monde, elle se détruit et s’anéantit elle-même. Autrement dit : plus il y a de peuples dans le monde qui entretiennent les uns avec les autres telle ou telle relation, plus il se créera de monde entre eux et plus ce monde sera grand et riche. Plus il y a de points de vue dans un peuple, à partir desquels il est possible de considérer le même monde que tous habitent également, plus la nation sera grande et ouverte. S’il devait inversement se produire que, suite à une énorme catastrophe, un seul peuple survive dans le monde, et s’il devait arriver que tous ses membres perçoivent et comprennent le monde à partir d’une seule perspective, vivant en plein consensus, le monde au sens historico-politique irait à sa perte, et ces hommes privés de monde qui subsisteraient sur la terre n’auraient guère plus d’affinité avec nous que ces tribus privés de monde et de relations que l’humanité européenne a trouvées lorsqu’elle a découvert de nouveaux continents et qui ont été reconquises par le monde des hommes ou exterminées dans que l’on se rende compte qu’elles appartenaient également à l’humanité. En d’autres termes, il ne peut y avoir d’hommes au sens propre que là où il y a un monde, et il ne peut y avoir de monde au sens propre que là où la pluralité du genre humain ne se réduit pas à la simple multiplication des exemplaires d’une espèce [1]."
Fragment 4
"Du désert et des oasis"
(Un chapitre de conclusion possible)
Conclusion : Ce que nous avons observé pourrait également être décrit comme la perte croissante du monde, la disparition de l’entre-deux. Il s’agit là de l’extension du désert, et le désert est le monde dans les conditions duquel nous nous mouvons.
C’est Nietzche qui, le premier, a reconn u le désert et c’est également lui qui dans son diagnostic et sa description a commis l’erreur décisive : Nietzsche pensait, comme tous ceux qui sont venus après lui, que le désert était en nous. Par ce diagnostic, il révèle qu’il était en lui-même l’un des premiers habitants conscients du désert.
Cette idée est à la base de la psychologie moderne. Elle est la psychologie du désert et également la victime de l’illusion la plus effrayante qui soit dans le désert, celle qui nous incite à penser que quelque chose en nous ne va pas, et ce parce que nous ne pouvons pas vivre dans les conditions de vie qui sont celles du désert, et que nous perdons par conséquent la capacité de juger, de souffrir et de condamner. Dans la mesure où la psychologie essaie d’"aider" les hommes, elle les aide à "s’adapter" aux conditions d’une vie désertique. Cela nous ôte notre seule espérance, à savoir l’espérance que nous, qui ne sommes pas le produit du désert, mais qui vivons tout de même en lui, sommes en mesure de transformer le désert en un monde humain. La psychologie met les choses sens dessus dessous ; car c’est précisément parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains, encore intacts. Le danger consiste en ce que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui [2]."
Quand France Culture recevait la traductrice : Le journal de la philosophie
Critique par Multitudes
Site de l’éditeur : Seuils
Wiki Arendt : Wikipedia
J’achète : Amazon
Voir le film "Hannah Arendt" de Margarethe von Trotta au Louxor
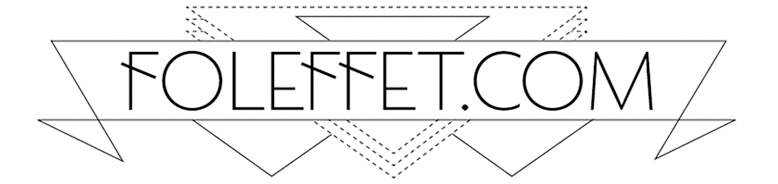
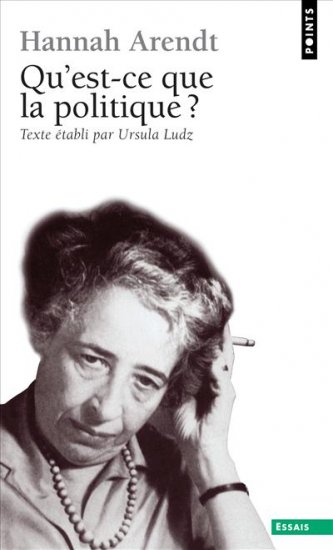
 riends
riends