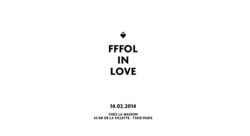Extrait de Théorie queer et cultures populaires de Foucault à Cronenberg de Teresa de Lauretis, traduction de Marie-Hélène Bourcier, préface de Pascale Molinier ; p.41-45. Ed La dispute, le genre du monde. 14€.
"1. Le genre est (une) représentation : ceci ne revient pas à dire qu’il n’a pas d’implications concrètes ou réelles, à la fois sociales et subjectives, dans la vie matérielle des individus. Bien au contraire.
2. La représentation du genre est sa construction, et l’on pourrait dire très simplement que tout l’art et la culture d’élite occidentale sont l’empreinte de l’histoire de cette construction.
3. La construction du genre se poursuit de manière aussi active aujourd’hui que ce fut le cas dans des temps plus anciens, l’époque victorienne par exemple. Elle perdure là où l’on peut s’y attendre – dans les médias, les écoles publiques et privées, les tribunaux, la famille, que celle-ci soit nucléaire étendue ou monoparentale, bref, dans ce que Louis Althusser a appelé « les appareils idéologiques d’Etat ». La construction du genre se poursuit aussi, même si c’est moins flagrant, à l’université, dans la communauté intellectuelle, les théories radicales et les pratiques artistiques avant-gardistes et même -peut-être même plus particulièrement- dans le féminisme.
4. Paradoxalement donc, la construction du genre est aussi affectée par sa déconstruction : c’est-à-dire par tout discours, féministe ou non, qui vise à l’écarter en tant que déformation idéologique. Car le genre, comme le réel, est non seulement l’effet de la représentation mais aussi son excès, c’est-à-dire ce qui reste en dehors du discours comme un traumatisme potentiel susceptible de briser ou de déstabiliser toute représentation s’il n’est pas contenu.
1
Lorsqu’on cherche « genre » (gender) dans un dictionnaire de la langue anglaise comme l’American Heritage, on trouve qu’il s’agit avant tout d’un terme de classification. Grammaticalement, c’est une catégorie grâce à laquelle les mots et les formes grammaticales sont répertoriées non seulement en fonction du sexe ou de l’absence de sexe (une catégorie en particulier : « le genre naturel », typique de la langue anglaise par exemple) mais aussi selon d’autres caractéristiques, telles que les caractéristiques morphologiques (« le genre grammatical » dans les langues romanes par exemple). Je me souviens de cet article de Roman Jakobson intitulé « Le sexe des corps célestes » dans lequel, après avoir analysé le genre des mots qui désignent le soleil et la lune dans une grande variété de langues, Jakobson en arrive à la conclusion rafraichissante qu’il n’existe pas de règle qui confirmerait l’idée selon laquelle il existe une loi universelle pour déterminer la masculinité ou la féminité du soleil ou de la lune. Que le ciel en soit remercié !
La deuxième signification de genre donnée par le dictionnaire est « classification du sexe, sexe ». De manière tout à fait intéressante, cette proximité de la grammaire et du sexe n’existe pas dans les langues romanes. L’espagnol género, l’italien genere et le français genre ne véhiculent même pas la connotation du genre d’une personne ; c’est le mot « sexe » qui s’en charge. Pour cette raison, il semblerait que le terme de genre emprunté au français pour désigner une classification spécifique des formes littéraires et artistiques (la peinture en premier lieu) est tout aussi dénué de dénotation sexuelle, comme le terme genus –l’étymologie latine de genre-utilisé en anglais comme un terme de classement en biologie et en logique. L’un des corollaires intéressants de cette particularité linguistique de l’anglais, à savoir cette acception de « genre » qui renvoie au sexe, est que la notion de genre dont je parle, et donc tout ce problème inextricable de la relation entre genre humain et représentation, est complétement intraduisible dans quelque langue romane que ce soit ; une réflexion qui devrait inciter à la modération quiconque pourrait être tenté d’épouser une conception internationaliste, pour ne pas dire universaliste du genre pour sa théorisation.
Pour en revenir au dictionnaire, nous y trouvons donc le terme « gender » est une représentation ; pas seulement au sens où chaque mot, chaque signe se réfère à (représente) son référent, qu’il s’agisse d’un objet, d’une chose ou d’un être animé. En fait, le terme « genre » renvoie à la représentation d’une relation, de l’appartenance à une classe, à un groupe ou à une catégorie. Le genre est la représentation d’une relation ou, si je peux empiéter un instant sur ma seconde proposition, le genre construit une relation entre une entité et d’autres entités, qui sont déjà constituées comme classes, et cette relation est de l’ordre de l’appartenance. Le genre assigne donc à une entité, disons à un individu, une position dans une classe et une position par rapport à d’autres classes préconstituées. J’utilise ici le terme de classe en toute connaissance de cause, bien que ce ne soit pas dans le sens exact de classes sociales. Ce que je veux garder de la conception de la classe comme groupe d’individus liés par des déterminations et des intérêts sociaux qui ne sont ni librement choisis ni arbitrairement donnés en y incluant de manière tout à fait significative l’idéologie. Le genre ne représente donc pas un individu mais une relation, une relation sociale ; en d’autres termes, il représente un individu en fonction d’une classe.
En anglais, une langue qui compte avec le genre naturel (notons au passage que la « nature » est toujours présente dans notre culture, depuis le commencement qui est justement le langage), le genre neutre est réservé à des mots qui se réfèrent à des entités sans sexe ou asexuées, des objets ou des individus marqués par l’absence de sexe. Les exceptions à cette règle témoignent de la sagesse populaire dans l’usage : un enfant est neutre du point de vue du genre et son adjectif possessif adéquat est its, comme on me l’a enseigné lorsque j’ai appris l’anglais il y a des années de cela, bien que la plupart des gens utilisent his et d’autres –quoique plus récemment et plus rarement, voire de manière tout à fait incohérente- utilisent his ou her. Bien qu’un enfant ait un sexe donné par la « nature », ce n’est que lorsque l’enfant (it, ça) devient (c’est-à-dire à partir du moment où c’est signifié comme) un garçon ou une fille que « ça » acquiert un genre [1]. . Ce que montre donc la sagesse populaire, c’est que le genre n’est pas le sexe, un état de nature, mais qu’il est la représentation de chaque individu dans le cadre d’une relation sociale particulière qui préexiste à l’individu et présuppose l’opposition conceptuelle et rigide (structurale) de deux sexes biologiques. Cette structure conceptuelle est ce que les chercheuses en sciences sociales féministes ont appelé le « système sexe/genre »."
Explication de texte : critique
Je commande ou je vais l’acheter : Violette & co
J’achète d’occasion : amazon
En savoir plus sur Teresa : Cairn
Petite bio et grande bibliographie de TDL : CDDC
Et encore un peu plus : "Displacing Hegemonic Discourses : Reflections on Feminist Theory in the 1980’s"
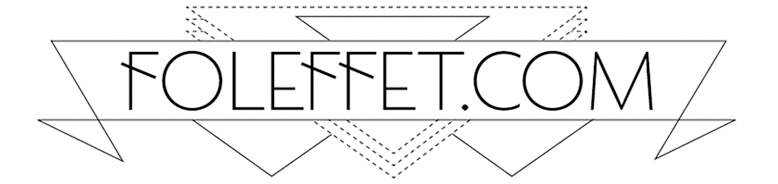

 riends
riends