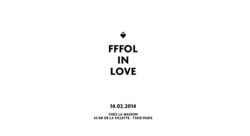« A peine portée sur les fonts baptismaux, l’ONU Femmes soulève beaucoup d’espoir mais aussi, déjà, quelques craintes. Les organisations non gouvernementales (ONG) se félicitent de la création, le 2 juillet à New York, d’une agence à part entière vouée à la "lutte contre les inégalités entre les sexes et à l’autonomisation des femmes". Des inégalités d’accès à l’éducation, aux soins, des discriminations dans le monde du travail à la persistance des violences sexistes ou à l’absence de parité dans le monde politique, les champs d’action de l’ONU Femmes sont vastes.
Dans la hiérarchie onusienne, sa secrétaire générale fera jeu égal avec les responsables d’autres grandes agences, comme l’Unicef ou le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). "C’est un magnifique pas dans la bonne direction, se réjouit Paula Donovan, cofondatrice de l’ONG Aids-Free World. Mais maintenant, il faut transformer les paroles en actes." Autrement dit, doter l’ONU Femmes d’un budget, d’un nombre de postes suffisants et nommer à sa tête une personnalité susceptible d’asseoir l’autorité et le rayonnement de l’agence.
L’ONU Femmes, qui sera opérationnelle en janvier 2011 et basée à New York, hérite des budgets et des équipes des quatre entités actuellement en charge, au sein de l’ONU, des questions de "genre" : la Division pour l’avancement des femmes (DAW) créée en 1946 ; le Fonds de développement des Nations unies pour les femmes (Unifem), la plus importante créée en 1976 ; l’Institut de recherche et de formation pour l’avancement des femmes (Instraw) établi la même année ; et enfin le Bureau du conseiller spécial sur les questions de genre (Osagi) ouvert en 1997. Un éclatement et une faiblesse - aucune n’est une agence à part entière - qui nuisaient à l’action en faveur des femmes, selon les ONG.
A elle seule, l’ONU Femmes disposera d’un budget de plus de 500 millions de dollars (386,2 millions d’euros), soit plus du double des moyens des quatre entités réunies (221 millions de dollars) qui avaient bénéficié d’un triplement de leurs budgets au cours des trois dernières années. "Cette somme restera de toute façon insuffisante compte tenu de l’échelle des problèmes à traiter, admet Moez Doraid, directeur adjoint de l’Unifem. Mais la création de l’ONU Femmes ne doit pas dispenser les autres agences de leurs efforts en faveur des femmes, au contraire." Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont promis qu’ils accorderaient à l’ONU Femmes le double de ce qu’ils versent aujourd’hui à l’Unifem, la plus importante des quatre entités. La France reste en retrait, au 17e rang parmi les pays donateurs.
Pour les 330 ONG regroupées dans la campagne pour la création d’une agence des femmes (Gender Equality Architecture Reform Campaign), le compte n’y est pas. Un milliard de dollars est un minimum. "La Banque mondiale a estimé, en 2008, de 60 à 80 milliards de dollars les besoins de financement pour réaliser l’Objectif du Millénaire numéro 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes)", rappelle Daniela Rosche, d’Oxfam. A titre de comparaison, l’Unicef s’appuie sur un budget de 3 milliards de dollars, le PNUD sur plus de 5 milliards.
Du montant de ce budget dépendra la force de frappe de l’agence. Si elle est "pauvre", elle devra se contenter de plaider la cause des femmes, tout en tenant un rôle de coordination au sein de l’ONU. Si ses moyens sont importants, elle pourra "être opérationnelle sur le terrain", comme l’espère Antonia Kirkland, de l’ONG américaine Equality Now. Mais "il n’est pas certain que cette perspective soit encouragée par les Etats membres. Nombre d’entre eux ne veulent pas d’un Unicef bis", résume Mme Rosche.
Car dans l’esprit de beaucoup de militantes des droits des femmes qui ont bataillé pour la création de cette agence, l’Unicef fait figure de modèle. "C’est une agence très efficace. Si son efficacité sur le terrain dépend de la taille de ses équipes, alors oui, l’ONU Femmes doit disposer de l’équivalent", estime Paula Donovan. Or, avec 284 personnes, l’effectif des quatre entités réunies au sein de l’agence est un poids plume face à celui de l’Unicef (7 200 personnes), du PNUD (3 334) ou même de l’Onusida (900). Moez Moraid, de l’Unifem, se veut rassurant et explique que l’ONU Femmes "s’appuiera" sur les structures du PNUD, présent dans 135 pays.
Enfin, le suspense est maintenu sur un point essentiel : qui sera nommé à sa tête ? De cette personnalité dépendra en partie l’envergure et la puissance de l’institution ainsi que "sa capacité à lever de nouveaux fonds et de convaincre les pays donateurs", estime Mme Kirkland. Sa nomination devrait intervenir au plus tard mi-septembre, date à laquelle l’ONU fera le point, aux deux tiers du parcours, de l’état d’avancement des Objectifs du Millénaire pour 2015.
Une liste de dix noms circule, qui comporte sept Africaines, mais dans laquelle n’apparaît pas celui de l’ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui fait pourtant toujours figure de favorite. Des rumeurs évoquent aussi la nomination de Mamphela Ramphele, militante anti-apartheid et ancienne directrice générale de la Banque mondiale. »
Source : Le Monde.fr
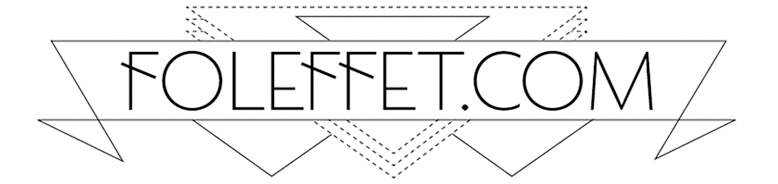

 riends
riends