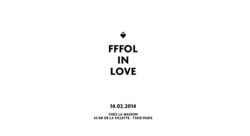Le SEMINAIRE mensuel du mercredi à 20 heures à LA MAISON POPULAIRE, réunira, philosophes, sociologues, historiens, activistes avec qui nous interrogerons et discuterons les questions du genre, des normes et de la transgression, à travers 9 rencontres, qui auront lieu entre les mois d’octobre 2007 et de mai 2008.
SÉMINAIRE ACCES LIBRE
Mercredi 24 octobre 2007 à 20h
ORIGINE ET PUISSANCE DES NORMES
Éric Fassin, sociologue et anthropologue, professeur à l’École normale supérieure
Frédéric Rambeau, professeur de philosophie à l’université Paris 8
Sabine Prokhoris, psychanalyste et philosophe.
Le séminaire a lieu en parrallèle du cycle de films féministes programmés par le peuple qui manque :
"La Maison Populaire de Montreuil et le Cinéma Le Méliès invitent cette année le peuple qui manque qui proposera et présentera dans le cadre des cycles annuels de cinéma (Les écrans sociaux au cinéma le Méliès un mercredi par mois) et de vidéos d’artistes (Sun in your head à la Maison populaire de Montreuil un vendredi par mois) un panorama de films rares, vidéos d’artistes, documentaires, films expérimentaux et d’avant-garde, en abordant tour à tour l’histoire des luttes féministes, la rencontre entre art et féminisme, les questions de genre, le mouvement homosexuel, l’Ecole du corps, les politiques transgenres, ou encore l’imbrication des rapports sociaux entre racisme et sexisme. Ces 14 rencontres de cinéma, d’octobre 2007 à mai 2008 prochain, constitueront une brève histoire du cinéma des corps et des identités, depuis les années 70, des mouvements de libération des femmes et d’affirmation des minorités sexuelles jusqu’au cinéma queer contemporain. En travaillant les normes sociales, sexuelles, raciales, et les représentations, les artistes s’évertuent à décoloniser nos imaginaires et à tenter d’inventer un langage cinématographique spécifique à ces positions minoritaires déclinant prises de conscience collectives, puissances de vie, stratégies politiques, fabriques de soi, déconstructions et mutations identitaires, hybridations et métissages."
« Force et précarité des normes » par Sabine Prokhoris, psychanalyste
Telle qu’on a habituellement tendance à la poser, la question des normes sociales semble comme par avance tranchée : les normes seraient ce qui, du monde social, s’impose à nous pour nous formater, et nous adapter aux valeurs dominantes dudit monde social. Face à leurs diktats, une alternative : soumission ou transgression. Soumission sans questions du côté d’une majorité bien adaptée, transgression du côté des minorités révoltées contre ce qui tend à les écraser. Alternative qui fait crédit aux normes d’une consistance et d’un pouvoir dont il convient peut-être d’interroger l’évidence. Car les normes sont-elles si solides, monolithiques, et en même temps si arbitraires, qu’on aimerait à le croire ? Comment existe une norme, en fait, et comment comprendre le processus de sa modification ? Processus auquel nous assistons aujourd’hui dans certains champs de notre expérience commune, celui en particulier du “dispositif de sexualité”, pour reprendre une expression de Michel Foucault. Le “dispositif de sexualité”, c’est-à-dire l’ensemble des normes qui gouvernent et organisent les discours et les pratiques du sexe dans notre culture. À partir de l’expérience de la psychanalyse, et de la réflexion qu’elle ouvre sur la puissance et l’instabilité des liens qui nous relient les uns aux autres, articulées à l’usage ordinaire du langage, j’aimerais faire apparaître comment les normes, au premier rang desquelles celles de la sexuation, exerceront d’autant plus d’emprise que leur précarité foncière sera méconnue.
![]() dernières publications de Sabine Prokhoris :
Le sexe prescrit, ed. Aubier 2000, rééd. Champs Flammarion 2002.
Fabriques de la danse, avec Simon Hecquet, éd. PUF 2007.
dernières publications de Sabine Prokhoris :
Le sexe prescrit, ed. Aubier 2000, rééd. Champs Flammarion 2002.
Fabriques de la danse, avec Simon Hecquet, éd. PUF 2007.
« Désir et désidentification » (Deleuze et le masochisme) par Frédéric Rambeau, agrégé en philosophie, ATER à l’université Paris 8
Tel qu’il est régulé et structuré par les relations de pouvoir, le désir est un site privilégié d’identification à soi. Deleuze et Guattari en proposent une autre expérience, celle d’un processus qui nous déprend de nous-mêmes. Ce processus n’a rien de naturel, ni de spontané ; il doit être construit par une discipline, une ascèse qui en fait la valeur émancipatrice. Le désir, dit Deleuze, et on peut bien le regretter d’ailleurs, ce n’est pas la fête. Je m’attacherai à un aspect de cette ascèse : la dissociation, pour le moins paradoxale, du désir et du plaisir. Deleuze l’élabore à partir d’un cas et d’une pratique, privilégiés dans sa philosophie : le masochisme. Le plaisir empêche le frayage du désir. Il est toujours pour le « moi » une manière de s’y retrouver. Le « travail » masochiste, à l’inverse, en écartant le plaisir et la satisfaction, crée un processus désirant. Mais il indique aussi sa part d’ombre et son danger : un effondrement toujours possible. L’expérimentation du désir ne se fait pas sans risques. Par-delà la fonction économique du plaisir, Deleuze et Guattari ne proposent rien d’autre que la pauvreté des moyens et la prudence du praticien. Mais contre l’injonction à jouir, perverse et dominatrice, contre les fantasmes morbides de destruction de soi, la prudence et la patience, nécessaires au long travail de désidentification, nous donnent la force, et le temps, de ne pas céder sur notre désir.
![]() dernières publications de Frédéric Rambeau :
Deleuze et l’inconscient impersonnel, Cahiers philosophiques, CNDP, octobre 2006, n°107.
La volonté de savoir : Droit de mort et pouvoir sur la vie, de Foucault, Michel et Bertrand Leclair, commentaires de Frédéric Rambeau, éd. Gallimard Folio plus, mai 2006.
dernières publications de Frédéric Rambeau :
Deleuze et l’inconscient impersonnel, Cahiers philosophiques, CNDP, octobre 2006, n°107.
La volonté de savoir : Droit de mort et pouvoir sur la vie, de Foucault, Michel et Bertrand Leclair, commentaires de Frédéric Rambeau, éd. Gallimard Folio plus, mai 2006.
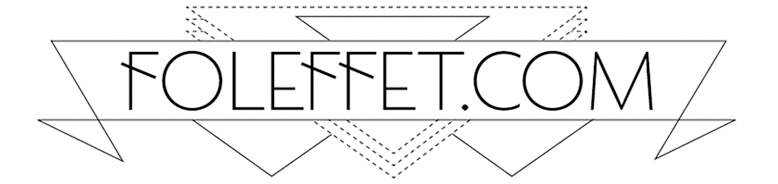

 riends
riends